
« Si on m’avait dit il y a 2 ans que je tomberais un jour en extase devant des diamants produits par l’homme, j’aurais crié au délire. »
Vous est-il déjà arrivé de regarder en arrière et de vous étonner du chemin parcouru ? De vous demander comment certaines convictions, jadis inébranlables, ont pu se métamorphoser complètement ?
Ça m’est arrivé deux fois, je vous raconte :
Acte I
On est en 1990, je viens de rentrer au marketing France de Kodak, la multinationale de l’image fondée il y a 1 siècle par Georges Eastman.
Un nom béni par les dieux de la science, des arts et du marketing, qui se prononce dans toutes les langues, un phare jaune et rouge qui brille sur les prestigieuses enseignes des grandes capitales comme sur les modestes échoppes des coins les plus reculés du globe.
On est à une époque où on rentre dans une multinationale comme en religion. J’y serai pour presque dix ans, la foi chevillée au corps pour la marque la plus prestigieuse au monde ex aequo avec Coca-Cola.
Emblème du capitalisme triomphant de l’occident, mécène des JO, budgets publicitaires stratosphériques, le claim « Kodak Moment » est générique du mot « photo ». La firme a nommé l’émotion photographique pour des siècles et des siècles, amen.
En 1999, lassée par le déni névrotique du titan de la photo face à la montée du digital, je quitte le navire.
Bien m’en a pris !
Le Titanic a sombré dans l’oubli, les milléniums connaissent à peine son nom.
Libérée de sa prison de papier, la photo s’affiche désormais l’espace d’une seconde sur un écran de smartphone avant d’être propulsée à la vitesse de la lumière à un public illimité.
Le temps, la pratique, la philosophie, l’esthétique, l’objet et la vocation même de la photo ont été bouleversés.
De mausolée de papier de notre intimité, la photo est désormais devenue une fenêtre ouverte sur le monde, une image éphémère mais publique de notre quotidien.
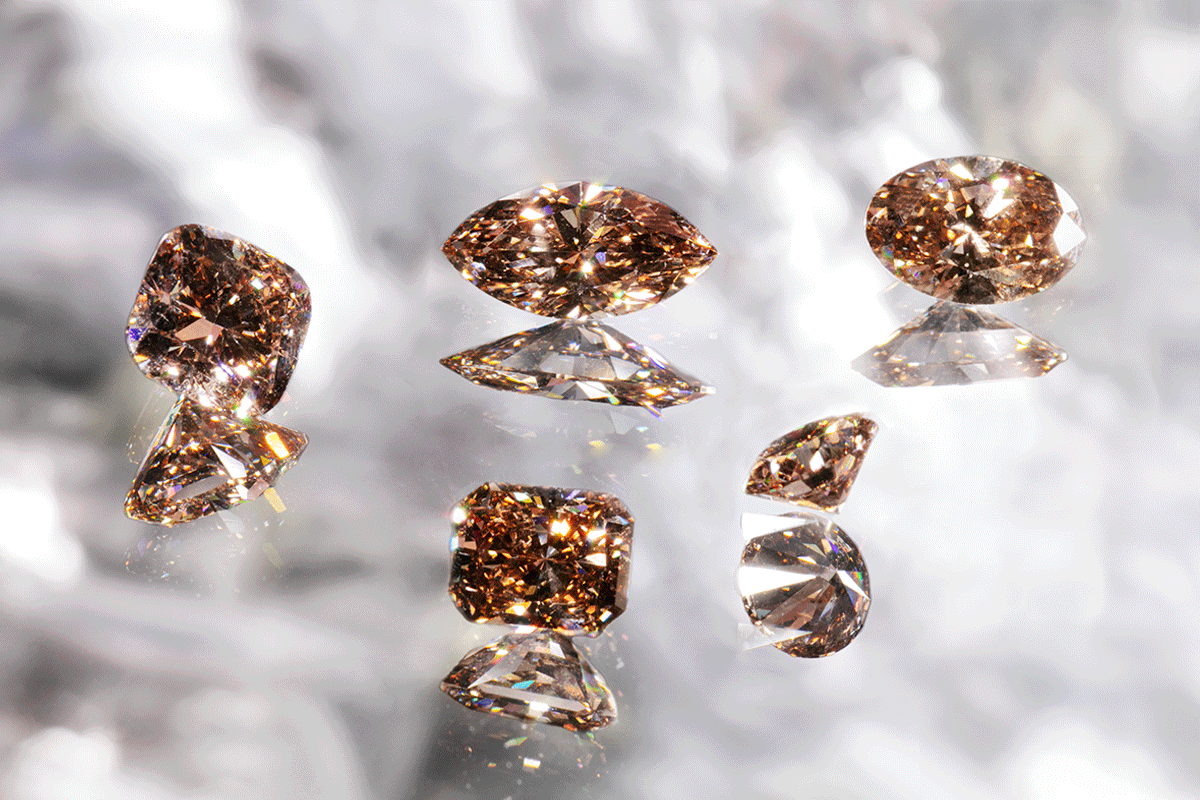
Acte II
Nous sommes en 2020 et des poussières.
Entre temps, ma boussole m’a menée loin du marketing de grande consommation, dans l’univers étincelant de la joaillerie, où j’ai exercé plusieurs métiers depuis presque deux décennies. Amoureuse des pierres précieuses et de l’artisanat joaillier depuis ma tendre enfance, j’ai le bijou tatoué dans mon ADN, comme la plupart des personnes que je croise dans ce monde où vie professionnelle se confond bien souvent avec passion.
Les matériaux précieux ciselés avec virtuosité par la main de l’homme font partie d’un rêve collectif dans lequel je joue mon rôle de conteuse.
Et si la lumière, la rareté, l’intimité et l’éternité sont l’essence même de ce rêve, c’est sans aucun doute parce que « A diamond is forever », le fameux slogan publicitaire lancé par De Beers en 1947 fait office de dogme, au même titre que le fameux « Kodak Moment » de ma jeunesse.
Et puis en 2021, mon chemin croise celui du LGD.
Un OVNI ?
Presque. Le Lab Grown Diamond est un diamant cultivé en laboratoire.
La différence avec un diamant de mine ?
Aucune, à part sa provenance.
Le premier est né d’une cristallisation du carbone dans le manteau terrestre ou dans l’univers, le deuxième a été reproduit par le génie humain après plus de 70 années de recherche.
Si on m’avait dit il y a 2 ans que je tomberais un jour en extase devant des diamants produits par l’homme, j’aurais crié au délire.
De la même façon que si on m’avait dit en 1990 qu’un jour, je prendrai et diffuserai toutes mes photos dans la seconde avec un téléphone.
C’est ça faire son chemin de Damas.
C’est croire à de nouveaux horizons.
C’est embrasser l’invisible avec la conviction du cœur, c’est construire des ponts là où l’œil ne voit que des abîmes.
Et vous, avez-vous vécu votre chemin de votre Damas ? Ces moments où vos certitudes se transforment en nouvelles vérités ? Racontez moi !
déjà
Par Sylvie Arkoun
Images de diamants de couleur Lab Grown Delphine Jouandeau







